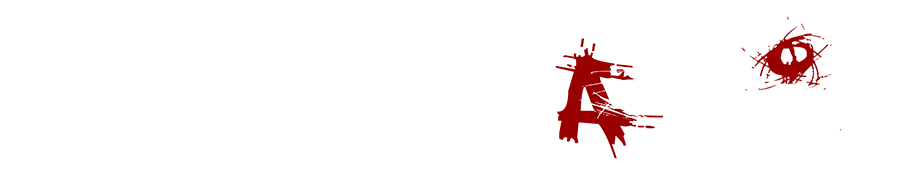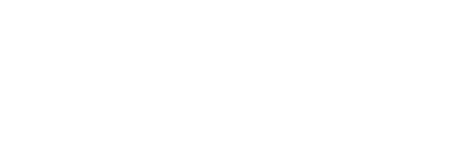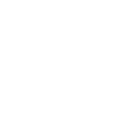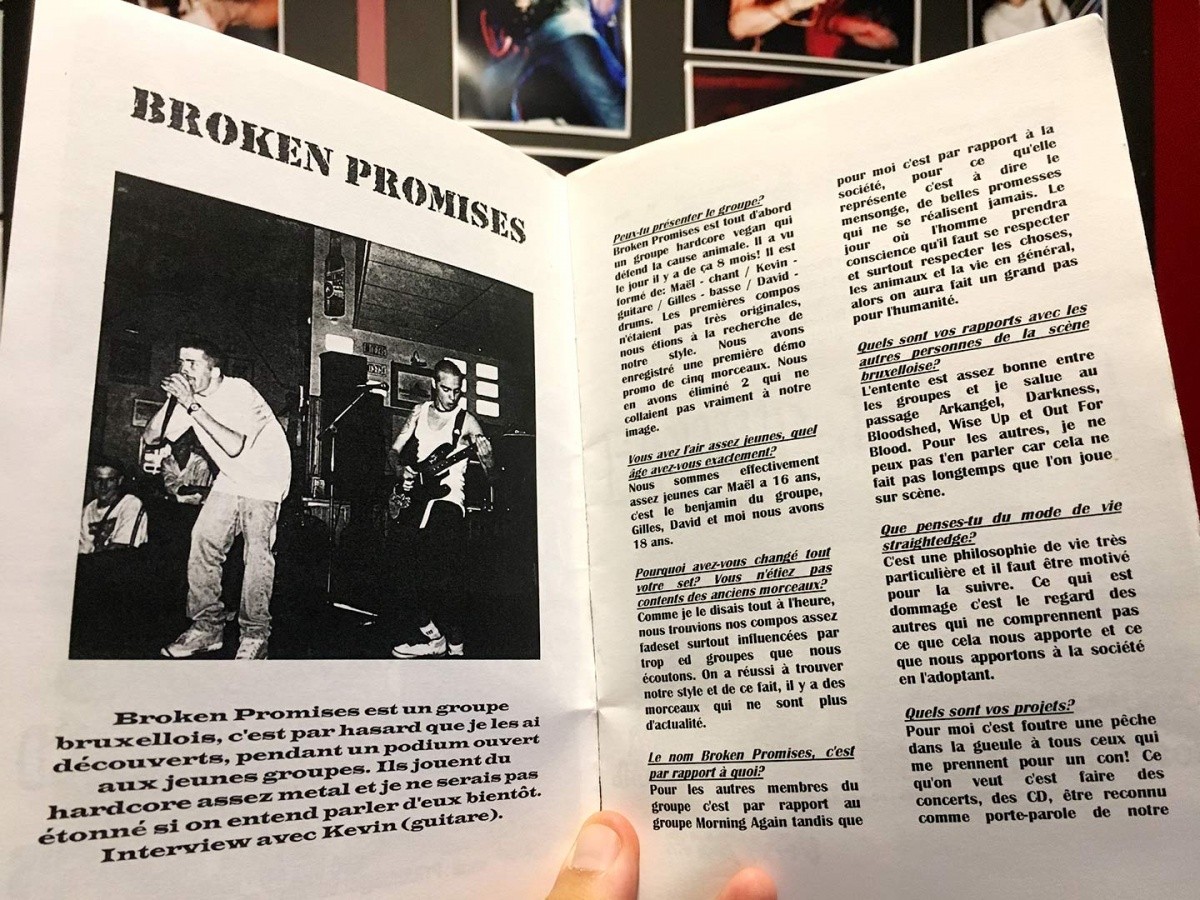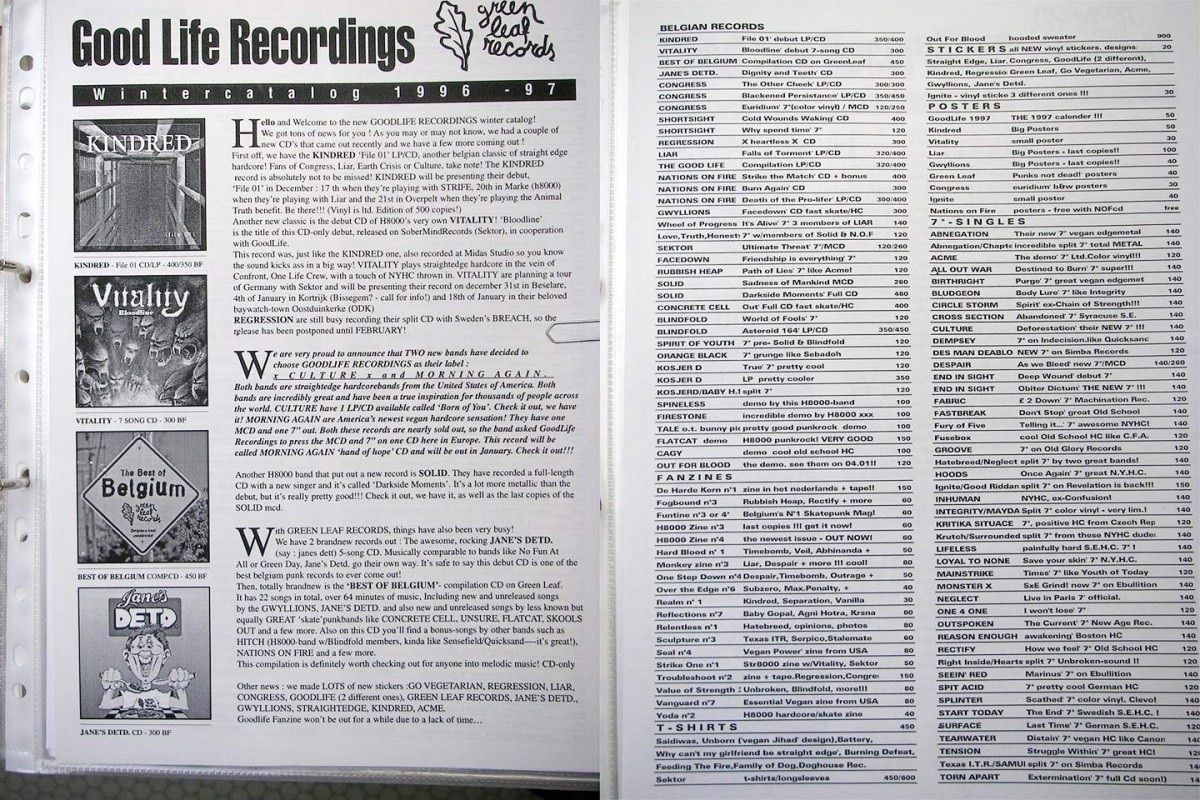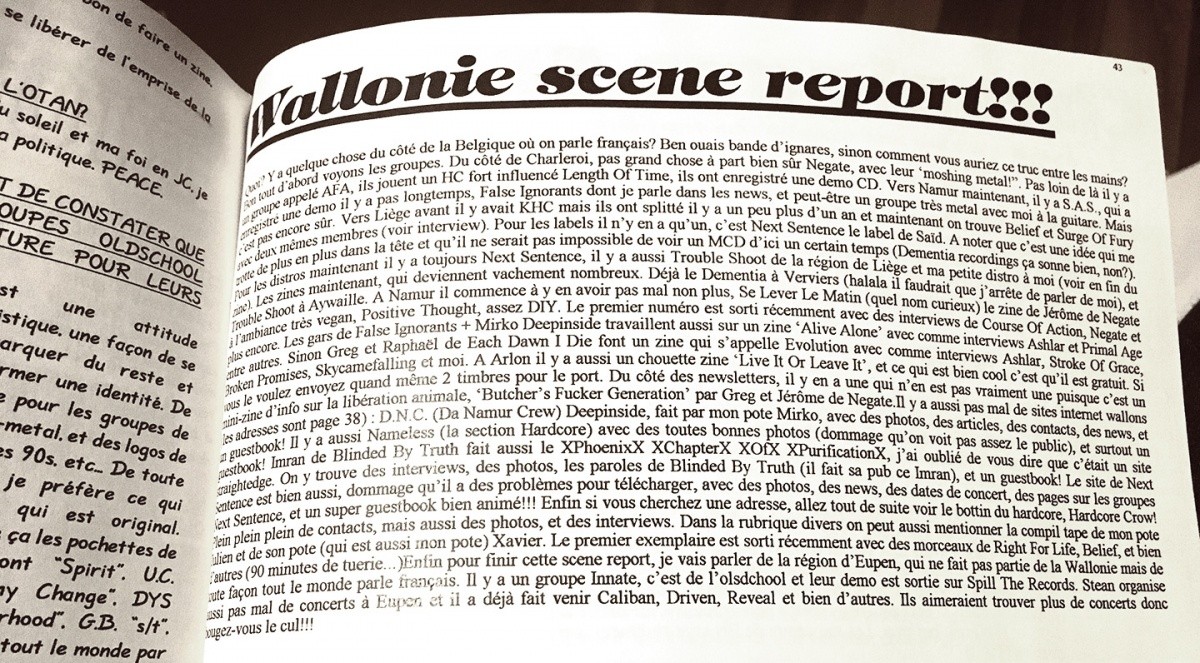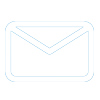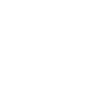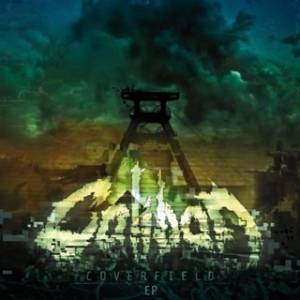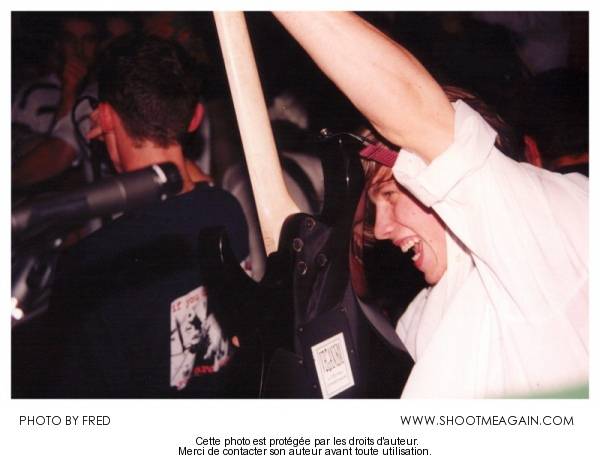AUTEUR : Erik
Rescapé de la scène hardcore underground de la fin des années 90, Erik a lancé Shoot Me Again en 2004 avec Julien, un autre gamin hyperactif de l'...
Rescapé de la scène hardcore underground de la fin des années 90, Erik a lancé Shoot Me Again en 2004 avec Julien, un autre gamin hyperactif de l'époque. Ecumant à eux deux les salles les plus improbables lors du lancement de ce webzine, ils se sont rapidement entourés d'autres camarades de jeu pour renforcer l'équipe. Aujourd'hui concentr�...
Rescapé de la scène hardcore underground de la fin des années 90, Erik a lancé Shoot Me Again en 2004 avec Julien, un autre gamin hyperactif de l'époque. Ecumant à eux deux les salles les plus improbables lors du lancement de ce webzine, ils se sont rapidement entourés d'autres camarades de jeu pour renforcer l'équipe. Aujourd'hui concentré sur le développement du site, il est moins présent sur le front. ...
Rescapé de la scène hardcore underground de la fin des années 90, Erik a lancé Shoot Me Again en 2004 avec Julien, un autre gamin hyperactif de l'époque. Ecumant à eux deux les salles les plus improbables lors du lancement de ce webzine, ils se sont rapidement entourés d'autres camarades de jeu pour renforcer l'équipe. Aujourd'hui concentré sur le développement du site, il est moins présent sur le front. ...
Rescapé de la scène hardcore underground de la fin des années 90, Erik a lancé Shoot Me Again en 2004 avec Julien, un autre gamin hyperactif de l'époque. Ecumant à eux deux les salles les plus improbables lors du lancement de ce webzine, ils se sont rapidement entourés d'autres camarades de jeu pour renforcer l'équipe. Aujourd'hui concentré sur le développement du site, il est moins présent sur le front. ...